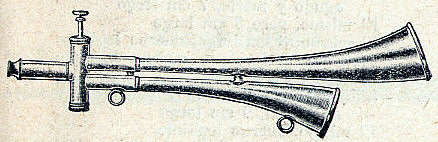|
Site
http://jeanluc.matte.free.fr
Typologie des instruments à
vent
selon leur
mode de production des notes
Fiches d'illustration
: schalmei ou "Martinophone"
|



Orchestre allemand (Schalmeikapelle Rot Front von Völklingen) de
joueurs de schalmei : instruments dans lequel l'air, insufflé
à la bouche dans un conduit unique, est réparti par une
série de pistons entre un ensemble de pavillons dotés
chacun d'une anche battante en laiton (comme les klaxons à
poire ou les cornes d'appel à anches).
Inventés en 1900 par l'allemand Max. B. Martin, ces
instruments se fabriquent encore de nos jours dans cette même
société " Martin ", dont l'activité semble
aujourd'hui bien plus orientée sur les klaxons automobiles et
de pompiers : voir leur site http://www.maxbmartin.de, à la rubrique "
Produkt " puis tout en bas " Martin Trumpeten ". Il faut dire que ces
instruments ont du être utilisés aussi bien comme comme
instruments de musique que comme instruments à produire des
signaux d'appels, sous des formes un peu plus simples.
Cet inventeur a en effet donné son nom à
l'instrument soit sous cette dernière forme, soit sous la
forme Martinshorn, soit, en français Martinophone. On ignore
pourquoi l'instrument a usurpé le nom schamei qui, en
allemand, est synonyme de hautbois et principalement utilisé
pour les hautbois anciens ou populaires. Le terme Martinshorn est,
aujourd'hui, davantage utilisé outre-Rhin pour désigner
les klaxons automobiles que l'instrument de fanfare...
La société Martin n'a pas été
la seule à fabriquer ce type d'instrument qui, à
l'imitation de la famille des saxhorns ou
autres cuivres du même type, prend diverses forme selon son
registre (voir la carte postale ci-dessus. Il existe également
des formes contrebasse à 4 pavillons et s'enroulant autour du
musicien à l'instar d'un hélicon.

Schalmei à 8 notes auquel fait défaut le tuyau
d'embouchure (sans incidence sur le jeu, cette embouchure peut
prendre des formes diverses : sorte de bec ou bien forme externe
d'embouchure de tuba). On remarquera que les trois pistons n'ont pas
le même débattement : il s'enfoncent tous les trois
jusqu'au niveau de leur bouton mais ne remontent pas de la même
hauteur.
Si l'instrument n'a que trois pistons, il
délivre tout de même huit notes (une gamme diatonique de
sol à sol) par combinaison de ceux-ci, même si,
contrairement aux véritables instruments à pistons, il
ne s'agit pas ici de rajouter des longeurs de tube mais simplement
d'orienter le soufflet vers l'un des huit pavillons, munis chacun
d'une anche à son départ. L'ordre des combinaisons
s'inspire un peu de celui des instruments à pistons mais il ne
faut pas chercher à pousser la comparaison car les instruments
à piston offrent une progression chromatique alors qu'ici on
en reste à une gamme diatonique. Voici le tableau de
doigté en considérant que le premier chiffre (à
gauche) correspond au piston près de la bouche (même
orientation que sur la photo ci-dessus) et que le chiffre 1 signifie
que le piston est enfoncé :
Sol : 0 0 0
La : 0 0 1
Si : 0 1 0
Do : 0 1 1
Ré : 1 0 0
Mi : 1 0 1
Fa : 1 1 0
Sol : 1 1 1
Examinons maintenant par quel astucieux
procédé, cet instrument permet toutes les combinaisons
de pistons : il est possible de démonter classiquement les
pistons, mais pas d'aller inspecter l'intérieur du bloc : il
va falloir faire des déduction à partir des canaux
visibles sur les pistons
 Le premier piston est doté de deux canaux
superposés, le premier envoi l'air vers la droite (position au
repos) et le second vers la gauche (piston appuyé).
Si ce premier piston peut nous faire penser aux classiques
pistons Périnet de nos trompettes, les deux autres pistons
sont bien plus simples avec de simples canaux horizontaux : deux
disposés à la même hauteur sur le piston du
milieu et quatre disposés à la même hauteur deux
par deux sur le dernier piston.
Le premier piston est doté de deux canaux
superposés, le premier envoi l'air vers la droite (position au
repos) et le second vers la gauche (piston appuyé).
Si ce premier piston peut nous faire penser aux classiques
pistons Périnet de nos trompettes, les deux autres pistons
sont bien plus simples avec de simples canaux horizontaux : deux
disposés à la même hauteur sur le piston du
milieu et quatre disposés à la même hauteur deux
par deux sur le dernier piston.

Nous avons vu que le premier piston distribue l'air soit vers la
droite, soit vers la gauche. Il est probable que les canaux qui
repartent tant à droite qu'à gauche, se divisent chacun
en deux : une partie monte tandis que l'autre descend. le canal
montant se retrouve face au canal du piston lorsque celui-ci au
repos, l'air peut alors passer tandis que le canal inférieur
est obturé. Lorsque l'on appuie sur le piston, le canal de
celui-ci descend, le canal supérieur s'obture tandis que le
canal inférieur est libéré.
La même opération se répète
avec le troisième piston : chacun des canaux
précédent se redivise à nouveau en deux et nous
avons donc, tant à droite qu'à gauche, quatre canaux
superposés (donc huit en tout) dont deux sont obturés
lorsque le piston et au repos et les deux autres lorsque le piston
est relâché.
En résumé, le premier piston effectue une
séparation en deux canaux sur un plan horizontal tandis que
les deux autres opèrent des séparations selon un axe
vertical. Le nombre de notes (nombre de pavillons) est donc
théoriquement égal à 2 à la puissance du
nombre de pistons : 1 piston = 2 notes
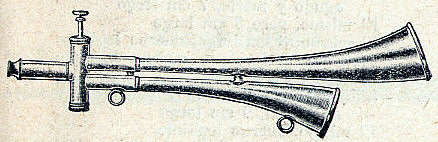
, 2 = 4 notes,
 3 = 8 notes comme ci-dessus et jusqu'à 4 pistons =
16 notes comme on peut le voir sur cette page :
http://pagesperso-orange.fr/trombonetubarun/insolites.html
ou sur le site du fabricant Martin cité plus haut : le
quatrième piston donne accès aux pavillons produisant
les notes altérées.
Mais il y a tout de même des exceptions comme vous
pouvez le voir sur la page :
http://www.horncollector.com/Other%20Instruments/Schalmei/Schalmei%20Horns.htm
: un instrument à trois pistons mais seulement 4 pavillons :
le troisième piston permet de produire non plus des notes
séparées mais un accord comme l'indique le texte de la
page 129 du catalogue ancien d'instruments de musique que j'ai mis en
ligne ici :
http://jeanluc.matte.free.fr/catal/catal.htm
et d'où sont tirés les trois instruments
dessinés sur la présente page...
3 = 8 notes comme ci-dessus et jusqu'à 4 pistons =
16 notes comme on peut le voir sur cette page :
http://pagesperso-orange.fr/trombonetubarun/insolites.html
ou sur le site du fabricant Martin cité plus haut : le
quatrième piston donne accès aux pavillons produisant
les notes altérées.
Mais il y a tout de même des exceptions comme vous
pouvez le voir sur la page :
http://www.horncollector.com/Other%20Instruments/Schalmei/Schalmei%20Horns.htm
: un instrument à trois pistons mais seulement 4 pavillons :
le troisième piston permet de produire non plus des notes
séparées mais un accord comme l'indique le texte de la
page 129 du catalogue ancien d'instruments de musique que j'ai mis en
ligne ici :
http://jeanluc.matte.free.fr/catal/catal.htm
et d'où sont tirés les trois instruments
dessinés sur la présente page...
 Il existe également des instruments à un
seul piston et quatre pavillons : deux accords de deux notes sont
possibles selon la position du piston (photo à venir).
Dans ce cas il s'agit très probablement plus d'un instrument
d'appel (destiné à produire des signaux sonores
audibles de loin) que d'un instrument de musique.
Et, plus étonnant, un schalmei chromatique à
16 pavillons, pour seulement trois pistons visibles, sur la page
http://www.isentaler-schalmeien.de/die_schalmei.htm
consacrée à cet instrument et son histoire au sein du
site d'un ensemble allemand : je n'ai pas encore trouvé
l'explication...
Dans l'annuaire Musique-Adresse de
1921 on relève à la page 329 cette publicité
de la maison français J-B Martin qui cite le martinophone
:
Il existe également des instruments à un
seul piston et quatre pavillons : deux accords de deux notes sont
possibles selon la position du piston (photo à venir).
Dans ce cas il s'agit très probablement plus d'un instrument
d'appel (destiné à produire des signaux sonores
audibles de loin) que d'un instrument de musique.
Et, plus étonnant, un schalmei chromatique à
16 pavillons, pour seulement trois pistons visibles, sur la page
http://www.isentaler-schalmeien.de/die_schalmei.htm
consacrée à cet instrument et son histoire au sein du
site d'un ensemble allemand : je n'ai pas encore trouvé
l'explication...
Dans l'annuaire Musique-Adresse de
1921 on relève à la page 329 cette publicité
de la maison français J-B Martin qui cite le martinophone
:

Y a-t-il un lien entre la maison allemande Martin et la maison
française J-B Martin ou bien n'est-ce qu'une reprise du nom ?
Vous pouvez encore voir un martinophone à huit
pavillons sur la page
http://pagesperso-orange.fr/musibrass/pages/martinophonepag.html
d'un collectionneur d'instrument
Les ensembles de Schalmei aujourd'hui...

Ensemble de Schalmei, Schleife, Allemagne, Lusace, 1997
(cliché David Bourger) Il doit s'agir de la
Schalmeienkapelle Cottbus
Ces ensembles sont encore nombreux en Allemagne comme on peut le
voir cette page de liens du site de l'un d'entre eux :
http://www.schalmeienzunft.de/links.htm ou en
tapant " schalmeien " sur un moteur de recherche.
Le caractère pour les moins original de ces instruments
leur a naturellement donné une place dans l'instrumentarium
des clowns, auprès du concertina et de la scie musicale (au
grand désespoir de ceux qui souhaitent que ces instruments
soient considérés comme des instrument à part
entière...)

4 martinophones de tonalités différentes et
un trombone à coulisse joués par "Les Zacchini et Cie"
au cirque Busch-Roland le 16-07-1975.
Cliché Radio-Télévision-Belge, document
fourni par Thierry Legros (cliquez sur l'image pour
l'ouvrir en grand dans un nouvel onglet)
En France, les Compagnons de la Chanson ont utilisé ces
instruments mais, actuellement deux ensembles à ma
connaissance jouent de ces instruments : en région parisienne
la fanfare Zek de l'association L'Armée du Chahut
http://larmeeduchahut.free.fr

(cliché X tirée de
leur
site, avec un arrosoir bigotphone sur la droite)
et en Alsace le Rhinau Schalmeien
http://www.rhinau-schalmeien.com

(cliché X tirée de
leur
site)

Retour à
l'article sur la typologie, Menu
général