|
|
Poursuivons le démontage de cet harmoniflûte du XIXème siècle commencé à la page précédente
En ouvrant le couvercle situé à l'opposé du clavier, nous pouvons voir, d'une part, les cavités des deux sommiers et, au milieu, les clapets actionnés par les touches du clavier.
Après avoir dévissé une vis de chaque
côté par l'intérieur et trois vis sur les
équerres en dessous, extrayons le clavier et ses clapets.
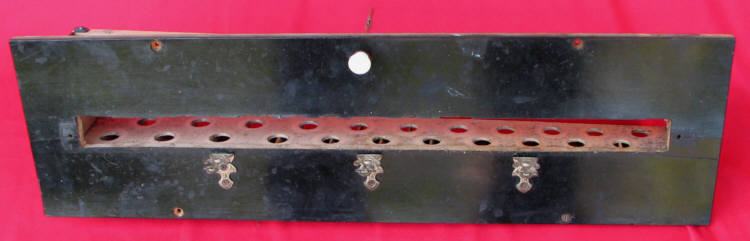
Nous voyons alors, sur les faces internes des sommiers, les orifices
circulaires correspondant à chaque clapet. Nous avons vu que
les soufflets mettent l'intérieur de la caisse sous pression ;
lorsque l'on joue une note, l'air passe donc d'abord à travers
l'anche correspondante, puis traverse la cavité du sommier
situé sous celle-ci, et s'échappe par l'orifice
circulaire de celle-ci, orifice que le clapet a libéré
lorsque le musicien a appuyé sur la touche. Il s'agit d'un
fonctionnement classique d'accordéon lorsque l'on comprime le
soufflet. La seule particularité ici est que l'air (et une
bonne partie du son) s'échappe ensuite à travers les
touches du clavier.
Voyons maintenant le clavier :

Toutes les touches pivotent autour d'un même axe dont
l'extrémité est cachée par la plaque
ouvragée marquée LT. Nous voyons que les clapets des
touches blanches sont dirigés vers le bas et ceux des touches
noires vers le haut.
En appuyant sur une touche blanche, par mouvement de bascule, le
clapet va monter et dégager ainsi l'orifice du sommier
placé sous lui.
Le fonctionnement des touches noires est un peu plus compliqué
: la tige de laiton sur laquelle est accroché le clapet n'est
pas directement solidaire de la touche : elle est fixée sur
une pièce de bois placée sous la touche et de
même largeur : en appuyant sur la touche noire, l'avant de
celle-ci vient peser sur cette pièce de bois, à
l'arrière de l'axe de celle-ci, et le clapet va donc
s'abaisser, libérant l'ouverture du sommier situé au
dessus de lui.
Sur la photo : touche noire enfoncée au milieu avec mouvement indiqué par les flèches roses et passage de l'air par la flêche verte. A la base de la flèche montante (désignant le mouvement de la touche noire), on distinque un petit patin de feutre cylindrique amortissant le contact entre la touche et la pièce de bois intermédiaire. On peut voir la position de deux touches noires au repos à gauche et à droite de celle actionnée, ainsi que l'extrémité de quatre touches noires avec leurs clapets vers le bas
En démontant la plaque de bout de clavier, on peut voir
l'axe principal autour duquel pivotent toutes les touches (blanches
ou noires) mais également l'axe secondaire autour duquel
pivotent les pièces de bois placées sous les touches
noires. Notons l'astuce de fabrication : le long trou dans lesquels
sont placés ces axes (dont la longueur est égale
à la largeur du clavier) est réalisé par taille
d'une rigole rebouchée par une cale de bois, comme on peut le
voir nettement ici sous l'axe secondaire :
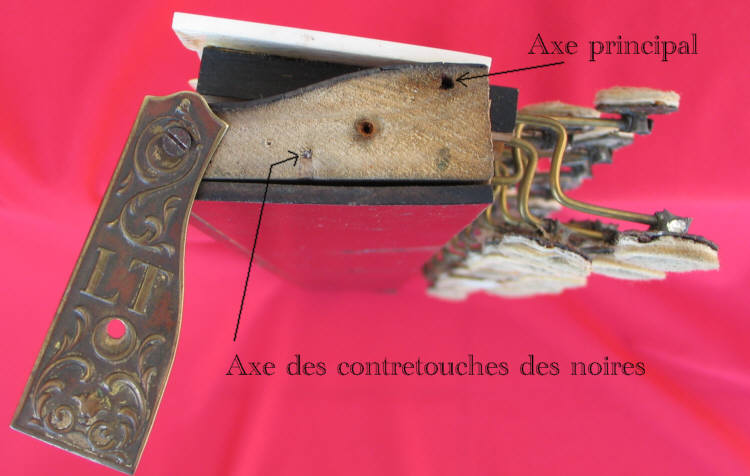
Le rappel des touches est assuré par de petits ressorts
à spirale disposés sous chacune d'elle :
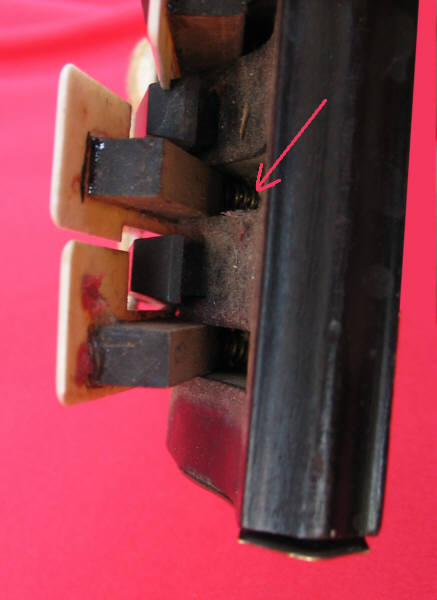
Cet instrument a déjà subi quelques restaurations,
certaines touches en ivoire ont été remplacées
par des touches en os et l'une des touches en ivoire, ici au centre,
probablement cassée sur l'avant a été
retaillée et repositionnée en avant :

Vue des sommiers (côté intérieur de la
caisse) sans leur couvercle et sans le clavier :

Sur cette vue de plus près du sommier en bas sur la photo précédente, nous voyons que chaque cavité de sommier dispose de deux ouvertures rectangulaires correspondant à deux anches (les ouvertures circulaires correspondant aux clapets sont, ici, sur le dessus, à peine visibles compte-tenu de l'angle de prise de vue.)
Examinons donc les anches de chaque sommier : Sommier du bas (dont nous avons vu qu'il correspondait aux notes blanches)
Et sommier du haut, correspondant aux touches noires, sur lequel nous reconnaissons l'alternance de deux notes, un trou, trois notes, un trou des touches noires du clavier, mais de manière dédoublée, c'est à dire 4 anches un trou de la largeur de deux anches, 6 anches et à nouveau un trou de la largeur de deux anches. Ceci confirme que chaque note du clavier correspond bien à deux anches et nous avons vu que cet instrument fonctionne uniquement avec un sens de passage de l'air et qu'il n'a donc pas besoin d'une anche pour le tiré et d'une pour le poussé. D'ailleurs vous aurez remarqué qu'aucune anche ne possède de petit cuir l'empêchant de fonctionner dans le sens qui ne serait pas le sien.
D'ailleurs, comme vous êtes très observateurs, vous avez également remarqué qu'une anche sur deux est décalée d'un demi-centimètre environ par rapport à ses voisines. et vous avez remarqué également cette grande barre de bois qui peut venir couvrir l'extrémité vibrante des anches décalées vers le couvercle des sommiers. Cette barre étant actionnée par le bouton visible en façade de l'instrument au dessus du clavier :

Il s'agit tout simplement d'un étouffoir permettant
d'empêcher la vibration d'une anche sur deux pour chaque
cavité du sommier, c'est à dire pour chaque clapet,
donc chaque touche du clavier. Nous avons donc déjà un
instrument à deux voix. Les deux anches d'une même notes
étant d'apparence identique, il s'agit de deux voix
destinées à être très
légèrement désaccordées de manière
à fournir un battement.
En regardant les sommiers par un de leurs côtés, nous voyons que le mécanisme de mise en place de l'étouffoir est renvoyé de l'autre côté afin d'agir également sur les notes non altérées.
Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, voici une photo des anches
des notes altérées sur laquelles j'ai indiqué le
nom des notes (pour simplifier j'ai tout noté en
dièses) et différencié les deux voix par a et b.
Vous pouvez donc voir que les anches de la voix a peuvent être
complètement étouffées.

En résumé, nous avons un instrument chromatique non "expressif" mais avec possibilité de jeu ininterrompu, alimenté par un seul petit soufflet, à un seul sens de circulation d'air et à deux voix dont l'une peut être étouffée en actinnant le petit bouton (registre) au dessus du clavier.
Notons enfin la différence de principe entre ce registre par appui sur les anches d'une voix et les registres habituels des accordéons par occlusion des passages d'air d'un sommier (voir par exemple sur la page de démontage d'un accordéon diatonique).
![]() Retour à la page
Harmoniums, Retour à l'article
sur la typologie, Menu
général
Retour à la page
Harmoniums, Retour à l'article
sur la typologie, Menu
général