

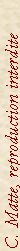 Références situées dans les
communes dont le nom commence par N
Références situées dans les
communes dont le nom commence par N

NANCY
(Meurthe-et-Moselle)
NANTES
(Loire-Atlantique)
NARBONNE (Aude) (voir fiche photos) :
Cathédrale St-Just, chapelle Notre-Dame de Béthléem, bas-relief
remis à jour en 1981 après la dépose des ornements en marbre
Sc/pierre : "Le Christ ressuscité, accompagné de musiciens,
descendant l'escalier, apparaît à Adam"
Fin XIVème, début XVème
Représentation abîmée
Sur cet ensemble voir le bulletin des Monuments historiques
n° 127, juin-juillet 1983 (photo. N.B. de l'ensemble, très
belles photos couleur... des autres scènes)
NARBONNE (Aude) (voir fiche photos) :
Cathédrale St-Just, chapelle Notre-Dame de Béthléem
Vitrail central, scène inférieure : annonce aux bergers
XIVème
Apparemment sans bourdon ou alors bourdon très court, très long
et fin chalumeau cylindrique se terminant par une petite tête
animale formant pavillon, petit porte vent, sac et tuyaux blancs
mais la partie supérieure du sac n'est pas visible.
L'orientation du porte-vent par rapport au chalumeau démontre
toutefois qu'il s'agit bien d'une cornemuse et non d'un simple
hautbois et d'un sac porté en bandoulière comme cela est parfois
le cas sur des vitraux de ce type.
NARBONNE (Aude) :
Musée des Beaux-Arts (don Peyre LB 596)
Tableau d'Adriaen Brouwer (1606-1638)
Début XVIIème : "Intérieur de tabagie", le musicien
debout, les genoux fléchis, joue pour un danseur ivre au centre
du tableau
Cornemuse difficilement discernable (sans bourdon)
NARBONNE (Aude) :
Musée des Beaux-Arts
Tableau (Huile sur bois) : "La danse de noce en plein air"
1620 , Brueghel le jeune (1564-1638) (signé et daté) d'après
Pieter Brueghel l'ancien (1520/25-1569). Voir autres versions à
Paris (Louvre), Quimper, Bordeaux, Nantes et Nîmes) Celui de Nîmes est très
semblable, la seule différence notable étant un léger recul de
la scène de l'arrière plan.
2 cornemuses à deux bourdons verticaux implantés haut
C.P. double format ed. Orient et simple format ed. du Musée
"L'opera completa di Brueghel", Milan 1967 (photo.)
Cité par G. Marlier op. cit.
NAOURS (Somme) : Eglise
Saint-Martin, voûte du chœur, cul de lampe à la base d’une
retombée d’ogive
Sc/pierre :
personnage en pieds, genoux pliés
XVIème
1
bourdon d’épaule extérieurement cylindrique mais paraissant un
peu plus large après le tore de mi-longueur et s’évasant en
pavillon. Tuyau mélodique difficile à identifier sur la photo
dont je dispose. Petit porte-vent non tenu en bouche. Sac sans
col de cygne bien dessiné. Le musicien tient le sac sous le bras
gauche, main gauche en haut et main droite en bas.
Cécilia Nicli
op. cit. fig.70
NAZELLES-NEGRON
(Indre-et-Loire) (voir
fiche photos) : Ancienne aumônerie devenue mairie.
Sculpture sur pierre : culot de retombée de larmier de fenêtre
sur le pignon donnant sur la rue, culot droit de la fenêtre de
gauche (rez-de-chaussée) : les quatre culots représentent des
personages accroupis (jambes repliées en arrière, pieds écartés)
et qui ont tous les épaules un peu proéminentes ce qui leur
donne une allure bien particulière. Deux instrumentistes :
cornemuse et sorte de luth à petite caisse, le troisième tient
une serpette et le quatrième porte les mains à son visage, à
proximité de sa bouche grande ouverte.
Fenêtres datant du XVème d'après Monumentum
Sans bourdon, tuyau mélodique conique, avec une conicité
légèrement plus prononcée sur le pavillon, ce dernier précédé
d'un très léger mais large tore. Deux trous de jeu visible sous
la main inférieure (la droite) et deux entre la droite et la
gauche, cette dernière cachant la souche de ce tuyau. Les mains
ne sont donc pas en position de jeu même si le tuyau porte-vent,
conique et sans souche marquée (semble le prolongement de la
forme du sac) est tenu en bouche.
NAZELLES-NEGRON
(Indre-et-Loire) : Château de la Huberdière (lieu de réception),
dans le petit escalier
gravures par Jean Philippe Le Bas, graveur au cabinet du Roi
* n°3 : fête flamande, dédiée à M. le Comte de Choiseul
* n°4: fête flamande, dédiée à Mme la Marquise de Pompadour
R. Amyot
NEUFCHATEAU (Vosges)
: Chapelle de l'hôpital, bas relief à l'intérieur de l'édifice
Sc/pierre: nativité avec annonce aux bergers
XVIème
Sans bourdon
M. Laissy, "Les Noëls populaires Lorrains" (photo. N.B.)
M. Vallas, "St-Nicolas et Noël en Lorraine" (photo. N.B.)
"Images du patrimoine : Neufchâteau" (photo)
NEUFCHATEAU (Vosges)
: Hôtel de Houstreville
Peinture ( ?) : trumeau avec couple de bergers dont l'homme
joue de la musette
Musette sans bourdon
"Images du patrimoine : Neufchâteau" (photo)
J.C.
Compagnon
NEUVILLER-SUR-MOSELLE
(Meurthe-et-Moselle) château, dessus de porte (d'après la
légende de la photo de l'Estampille, ne serait plus dans ce
château…)
Bois sculpté décoré d'un trophée d'instruments de musique
comportant une cornemuse.
Figuration est extrêmement simplifiée : un porte-vent et -
semble-t-il - deux tuyaux parallèles (dont l'un terminé par un
pavillon) percés de trous et montés surune poche en forme de
haricot
L'Estampille-L'Objet d'Art, n° 387, janvier 2004 (photo
p.60)
P.
Boulanger
NEVERS
(Nièvre)
NICE ( Alpes-Maritimes)
: Musée des Beaux Arts Jules Chéret (N-Mba 1870, leg du
docteur Jules Feraud en 1912)
Tableau de Camille Pabst (1821-1898) intitulé "Triboulet et la
maîtresse du roi" et inspiré de la pièce de Victor Hugo "Le roi
s'amuse". Le fou du roi François 1er, Nicolas Ferrial dit
"Triboulet", tout de rouge vêtu est négligemment assis sur une
grosse chaise, le menton posé sur ses deux mains, elles mêmes
croisées sur la tête de sa marotte. Il a une jambe ramenée sur
le devant du piétement de la chaise (tabouret ?). Son coude
droit s'appue sur un tissus de velours vert qui semble posé sur
la rambarde de l'escalier (ou s'agit-il d'un meuble ?). Il
regarde le peintre d'un air narquois. Debout à sa gauche, une
femme nue (la maîtresse du roi du titre du tableau), de face,
dans une belle pose, le buste penché sur la gauche, appuie deux
doigts sur l'épaule du fou qu'elle semble toiser du regard, tout
en tenant un miroir de la main gauche. Une étoffe blanche est
pendue à son coude droit et une bleu à son coude gauche. Une
ouverture entre une rangée de colonnes rondes derrière elle, à
droite de la composition, laisse entrevoir un bâtiment de brique
à toit d'ardoises. Une cornemuse est posée à terre devant elle,
au dessus d'un marche en marbre. L'instrument est dégonflé et
son grand bourdon, revient à l'arrière de la poche, orienté dans
le même sens que le hautbois et le petit bourdon, eux même
appuyés sur la poche. Une petite tortue, sur la marche
inférieure, lève la tête vers l'instrument.
Fin XIXème (tableau de style pompier)
Grande musette du centre (Bourbonnais-Nivernais) incrustée
d'étain très fidèlement représentée : un grand bourdon en trois
partie et un petit bourdon parallèle en deux. Hautbois conique.
L'ensemble boitier, petit bourdon et hautbois rest vu par
derrière comme en témoigne la place respective du petit bourdon
et du hautbois (mais il auraient pu avoir été inversés) mais,
surtout, la présence du seul trou de pouce et d'un trou d'accord
sur le hautbois..
CP ed. direction des Musées de France
J.C.
Compagnon
NICE
(Gard) (voir fiche
photos) : Palais Lascaris (musée des instruments de
musique), 1er étage, salle des Chevaliers de Malte, porte
battantes "à l'italienne", battant de gauche en allant dans la
dernière pièce du fond
Plaques de cuivres argentées (sans relief) : trophée avec
musette devant une faux, un rateau et une bêche, surmontée d'un
tambour de basque (?) et d'une sorte de trompe à l'extrémité
coudée. Les boiseries de cette pièce renferment deux autre
trophées avec instruments, en bas relief cette fois-ci et d'une
représentation plus fidèle : le premier avec hautbois (peu
conique) et trompette naturelle (1 tour et demi, forme assez
allongée), le second avec flûte traversière et guitare.
1760-80 : porte milieu XVIIIème décorées de boiseries un peu
plus tard ors d'un réaménagement.
Musette très schématique :un sac piriforme mais sans col de
cygne, doté d'une très grosse souche moulurée de laquelle
s'échappe un petit tuyau mélodique s'évasant en pavillon. Un
gros et très court tuyau (pavillon) mouluré est placé à
l'extrémité opposée du sac et un troisième tuyau, réduit à un
simple pavillon court et de gros diamètre est visible en haut du
sac, sans que l'on sache s'il appartient ou non à l'instrument.
NICE
(Gard) (voir fiche
photos) : Palais Lascaris (musée des instruments de
musique) : harpe Naderman à simple mouvement , table (Coll.Palais
Lascaris, achat ville de Nice inv PL 2007.9.1)
Peinture sur bois : trophée avec musette, trompette et tambour
de basque, roses et leurs feuillages et deux petits objets bruns
non identifiés. Trois autres trophées : un avec nacaires et
carquois, un avec pigeon, chapeau champêtre, panier, torches et
un tuyau qui pourrait être une tête de flûte traversière, le
dernier , face à celui avec musette (de l'autre côté des cordes)
avec luth, cor à un our et demi, une autre tête de flûte
traversière et un pavillon qui pourrait être de hautbois,
toujours sur fond de roses mais avec une partition.
1780 à Paris
Musette stylisée à deux chalumeaux de longeurs inégales mais
tous deux relativement courts et s'évasant en pavillons bruns
alors que leurs tuyaux, plus cylindriques sont noirs. Une boîte
à bourdons dont les layettes sont stylisées mais qui présente la
forme caractéristique de son extrémité. pas de porte-vent ni
soufflet visible, housse rouge et galons bruns.
NIEUL-SUR-L'AUTISE
(Vendée) :cloître de l’abbaye, galeries hautes
Sculpture/pierre en haut relief : Singe joueur de cornemuse,
assis, aux jambes croisées. Copie récente d'un claveau du
portail Nord de l’église Notre
Dame de Vouvant (85).
Réalisée en 2002 sous la Direction de Richard LEVESQUE , alors
Conservateur des Antiquités et objets d’art de la Vendée dans le
cadre d'un projet visant à mettre en avant la musique médiévale
au travers de sculptures (personnage et instrument) trouvées sur
des chapiteaux, des modillons… de différentes églises de Vendée
et surtout une mise en relation du modèle de pierre et de
l’instrument qui peut en découler. Ces sculptures, ont donné
lieu à la fabrication de répliques et à la fabrication de chaque
instrument (sept : cor, cornemuse, muse à corne,
rote-psaltérion, harpe, vièle ovoïde et vièle piriforme) qui
sont exposés dans cette galerie.
Un bourdon d'épaule à raccord médian bien visible, pavillon
précédé d'un bourelet et bourelet supplémentaire entre le
raccord et le pavillon. Tuyau mélodique extérieurement conique,
assez court. Porte-vent cylindrique, d'assez fort diamètre et
tenu en bouche.
"La Musique des Pierres", édité par le Conseil Général de la
Vendée
http://photosfrancecotesouest.eklablog.fr/abbaye-de-nieul-sur-l-autise-c26994768/13
(photo)
NIMES (Gard) : Musée des
Beaux-Arts (inv. N°01257)
Tableau (Huile sur toile) de Jules Salles d'après le tableau de
Léopold Robert conservé au Louvre (cf. ref.) :
"Moissonneurs dans le Marais Pontin"
Zampogna
P. Sagnier
NIMES (Gard) :
Musée des Beaux-Arts (inv. IP 983)
Gravure : série complètes des gravures d'Etienne Fessard
représentant les peintures de l'"Hospice des enfants trouvés" de
Paris, premier tableau droit latéral (premier tableau du cortège
des bergers). Cet hospice fut construit en 1746 derrière
Notre-Dame, à l'emplacement actuel de l'Hôtel-Dieu, et décoré en
trompe l'oeil par Charles Joseph Natoire (Nîmes 1700 -
Castel-Gondolfo 1777), Brunetti (?-1748) et son fils Paolo
Antonio Brunetti (1723-1789). Ce bâtiment n'existe plus
aujourd'hui (détruit en 1868 et 1878)
Peinture originale de 1746-1750, la gravure de Fessard date de
1754
Deux cornemuses et un hautbois (trompette droite ?) :
* cornemuse de droite à un bourdon d'épaule à une coulisse,
très mouluré (rappelle certains bourdons flamands) et dont les
deux parties sont reliées par une chaînette ornée d'un gland,
hautbois conique
Ce personnage et son instrument ont fait l'objet d'une
étude préliminaire de Natoire lui-même (Paris, Musée du
Louvre, cabinet des dessins, cf. ref.)
* cornemuse de gauche à un bourdon d'épaule non entièrement
visible, plus fin, terminé par un large pavillon; hautbois
conique et petit bourdon parallèle.
Musée d'Art et d'Histoire de Nîmes, "Charles Joseph Natoire,
peintures, dessins, estampes et tapisseries des collections
publiques françaises" (photo. N.B.)
Cité par A.P. de Mirimonde
op. cit. t.1 p.110, L. Duclaux 1971 et 1975 , E. Pognon et Y.
Bruand 1962
Couverture du n°14 d’Utriculus, avril-juin 1995 (version
coloriée de la gravure)
P. Sagnier
NIMES (Gard) :
Musée des Beaux-Arts (inv. N°1286)
Tableau très certainement attribuable à P. Brueghel le jeune
(1564-1638) d'après Pieter Brueghel l'ancien (1520/25-1569)
"Danse de la mariée en plein-air", version avec cornemuseux à
droite, très proche de la version signée et datée conservée au
Musée de Narbonne (cf. ref.) qui comporte également le
deuxième arbre à droite destiné à modifier le format par rapport
aux autres versions de ce tableau (voir également à Paris (Louvre), Quimper, Bordeaux, Nantes, et Narbonne ) ). La plaque apposée sur
le cadre du tableau porte le titre erroné "Kermesse flamande" et
une attribution plus que douteuse à P. Brueghel le Vieux.
2 flamandes à 2 bourdons verticaux implantés haut
G. Marlier op. cit. le cite
dans la liste des versions avec cornemuseux à gauche, il y a
donc erreur dans cet ouvrage par ailleurs indispensable pour
s'y reconnaître entre les différentes versions des tableaux de
la famille Brueghel.
MC. &
P. Bollier
NIMES (Gard) : Dans l'ouvrage "Nimes
Gallo-Romain, Guide du Touriste-Archéologue, par Hippolyte
Bazin, Agrégé de l' Université, Docteur Es Lettres,
Correspondant du Ministère de l' Instruction Publique pour les
Travaux Historiques". Edition Hachette et Cie, Paris,
1892, on peut lire au chapitre "Le Musée Archéologique",
sous-chapitre "Statues et bas-reliefs", cette description,
mlaheureusement sans illustrtion alors que l'ouvrage en comporte :
" Patre joueur de cornemuse. Le jeune homme est représenté
vêtu de l' exomis qui laisse à découvert son épaule droite et
qui, attaché par un noeud au dessus du bras gauche, descend
jusqu' au genou. La cornemuse est suspendue à une lanière mais
le pâtre la soutient en infléchissant la main. Sous l' autre
bras, il porte un petit chevreau. La statue est malheureusement
mutilée. Il manque la tête de l' homme, la jambe droite à partir
de la cuisse, la gauche à partir du genou, la tête ainsi que les
pattes de devant de l' animal. Mais, telle qu' elle est, elle ne
manque pas de valeur. La pose est des plus gracieuses. L'
artiste a su rendre avec beaucoup de naturel et de vérité le
modelé de ce corps d' adolescent dont les muscles ont été
développés par l' exercice. Hauteur du fragment, 1m08 ".
Mes correspondants n'ont malheureusement pas trouvé trace d'un
cornemuseux correspondant à cette description dans ce musée.
NIORT (Deux-Sèvres)
: Musée du Pilori (Musée Bernard d’Agescy)
Manche de couteau en ivoire, trouvé au Bernard (Vendée) :
berger debout vêtu d’une sorte de bure à capuchon, portant à la
ceinture un petit sac quadrillé et les ustensiles du berger
(couteau etc…)
2ème quart XIVème
Sans bourdon, pied de section rectangulaire dont la partie
droite est légèrement plus longue, porte-vent en bouche
C.P. éditée par l’association Musées vivants de Niort et
Cat. expo. "Les fastes du gothique; le siècle de Charles V"
Paris 1981/82 (photo. N.B.)
Fiche avec photo visible sur le portail Aliénor du réseau
des musées ("Conseil des musées") de la Nouvelle-Aquitaine à
l'adresse :
https://www.alienor.org/collections/oeuvre/17519-couteau-manche-joueur-de-cornemuse
P.
Boulanger
NITRY (Yonne) (voir fiche photos) : auberge
/ hôtel "La Beursaudière"
Peinture murale: scène de danse avec joueur de cornemuse assis
sur un tonneau; le pied droit replié sous lui. Signé V. Perrin
Fin XXème ou début XXIème
1 bourdon d'épaule en trois parties dont la dernière présente
un renflement médian et un pavillon. Tuyau mélodique à pavillon
et petit bourdon parallèle à peine plus court et présentant le
même petit pavillon. Tous les tuyaux sont représentés par un
trait assez fin (violet), Tuyau mélodique et petit bourdon ne
sont pas représentés entre les mains du musicien et le sac. Pas
de porte-vent visible, vu la position assez basse du sac, il
pourrait s'agir d'une cornemuse à soufflet (non visible). sac
brun. Bien que la représentation de l'instrument soit assez
schématique, l'impression générale est assez réaliste.
C. Saunière
et J. Mc-Iver
NOGENT-LE-ROTROU
(Eure-et-Loir) : Château-Saint-Jean, manuscrits de Noëls de
Moutiers au Perche
Gravure coloriée (incunable ?), gravure séparée de son ouvrage
d'origine : lettrine L du mot "Laissez" avec scène d'annonce aux
bergers: berger debout devant une colonne formant la partie
verticale de la lettre L, tenant sa cornemuse sous le bras droit
et portant sa main gauche au dessus de yeux pour regarder l'ange
annonciateur (dans le ciel en haut à droite de la scène). Un
second berger légèrement en arrière plan marche en s'appuyant
sur sa houlette, lève également sa main droite, mais, la tête
tournée en arrière, regarde non en direction de l'ange mais en
direction du berger cornemuseux. Décor de campagne avec chateaux
sur collines.
2 bourdons d'épaule divergents, coniques très évasés, de même
longueur moyenne, petit porte vent que le musicien tient de la
main, mais pas de hautbois (!), sac piriforme gris.
M. Vanden
Bemden Casier
NOGENT-LE-ROTROU
(Eure-et-Loir) : Château-Saint-Jean, manuscrits de Noëls - Gabriel
Hubert (Nogent)
Gravure coloriée (incunable ?), gravure séparée de son ouvrage
d'origine : scène d'annonce aux bergers: deux bergers debout de
dos ou de profil à gauche et à droite de la scène écoutent la
parole de l'ange annonciateur (au milieu du ciel dans un nuage
bleu, tandis que le berger cornemuseux, assis de face très
légèrement en avant, continue impassiblement à souffler dans son
instrument, son chien endormi à ses pieds
1 long bourdon d'épaule extérieurement conique à raccord
médian, hautbois relativement court, porte-vent
M. Vanden
Bemden Casier
NOHANT-VIC
(Indre)
NOVEANT (Moselle) (voir fiche photos) :
Centre Socio culturel, façade
Mosaïque réalisée en carreau de terre cuite, miroirs et pâte de
verre sous la direction artistique et technique de Danièle
Lacrabère. Les carreaux ont été gravés avant cuisson par les
enfants des écoles et les visiteurs de l'exposition de juin
2005. L'un des carreaux représente deux cornemuses zoomorphes
dans un style humoristique, la plus petite soufflant sur la
grosse.
2005
1 bourdon d'épaule à 1 raccord, hautbois conique
NOVY (Ardennes) : Eglise,
tribune de l'orgue
Sc/bois
XVIIIème
Trophée d'instruments dans lequel un tuyau emmanché dans un sac
est censé représenter une musette
"Les Ardennes", coll. "Richesses de France", ed. J. Delmas
(photo. N.B.)
NOYAL-PONTIVY
(Morbihan) : Eglise, vitrail (rose)
Vitrail : concert d'ange autour d'un Dieu le père, dans des
lancettes séparées : harpe, cornemuse, guiterne, tambour etc...
Avec également des têtes d'angelots et des étoiles. Le
cornemuseux est vêtu d'une robe rouge franc. Il joue avec le
tuyau mélodique tenu quasi horizontalement
XIXème ouXXème ?
Sans bourdon, tuyau mélodique extérieurement conique s'évasant
assez largement en pavillon, la main gauche de l'ange étant
curieusement placée sur ce pavillon. Sac blanc à col de cygne
(curieusement la partie sous le col de cygne n'est pas rouge
comme elle devrait l'être, laissant voir la robe de l'ange).
Petit porte vent en bouche.
Photo de "Gerfaut" sur Flickr.com
NOYAL-SUR-BRUTZ
(Loire-Atlantique) : Ancienne léproserie, aujourd'hui bâtiment
privé
Fresque murale très dégradée (peut-être complètement disparue à
l'heure actuelle ?)
XIXème : nativité (allégorie), personnages locaux
dont un cornemuseux
P. Bardoul
NOYON (Oise) :
Cathédrale ?
Vitrail
C. Novoa Gonzalez op.
cit. p.106
Fr.
Schneider
NOYON (Oise) :(voir
fiche
photos) : Cathédrale, trésor, armoire, intérieur de
la porte droite (cette armoire ne serait plus dans la
cathédrale, perdue ou détruite lors des conflits du XXème
siècle ?)
Sc/bois
XIVème
Dans l'ouvrage cité ci-dessous, M. Didron précise, en sus de la
gravure reproduite ci-dessous : "Sur l'intérieur de ces volets,
l'artiste a représenté la musique céleste, sous la forme d'un
quatuor d'anges, dont trois, encore existants et dont nous
donnons la gravure, tiennent une clarinette, une cornemuse et un
petit orgue à soufflet ; le quatrième, qui n'existe plus,
pinçait probablement de la harpe. Ces anges sont vêtus de blanc
et se détachent sur un fond, tantôt pourpre foncé, tantôt vert
et parsemé d'étoiles. Deux autres anges tiennent des
chandeliers, et les deux derniers encensent ; nous avons fait
graver un de ces encenseurs."
1 bourdon d'épaule s'évasant très largement en pavillon après
un raccord aux deux tiers de sa longueur environ. Tuyau
mélodique assez fort, extérieurement cylindrique et s'évasant en
pavillon. Sac formant un col de cygne, porte-vent tenu en
bouche.
M. Didron, "Armoire de Noyon", Annales archéologiques, 4,
Paris 1846 p369-375 (gravure) (note : ce volum des annales
archéologiques comporte également la première partie d'un
"essai sur les instruments de musique au moyen age - 1
instruments à vent" par E. de Coussemaker
Fr.
Schneider
NOYON (Oise) : Hôtel de
ville, exposé au salon du deuxième étage
Biscuit de porcelaine de la manufacture de Sèvres en haut
relief : "Couronnement de la rosière de Salency" ou "La
vertu récompensée" : un homme debout vient poser une
couronne sur la tête d'une jeune femme assise (mais ne volant
pas au vent). Quatre personnages secondaires les entourent : sur
la gauche une jeune femme un genou en terre présentant un panier
de fleur, un jeune homme jouant d'une petite cornemuse et, sur
la droite, un personnage portant un drapeau hampe dressé mais le
grand drapeau proprement dit retenu le long de sa hampe, et un
jeune-homme cachant sa tête derrière un miroir (?) ovale. Tous
sont noblement vêtus, les hommes portent perruque.
XXème, manufacture de Sèvres, Josse-François-Joseph
Leriche (1741-1812) d'après un original de Simon Louis Boizot
(1743-1809) conçu en 1776
Pas de bourdon visible sur la photo du site POP mais présence
d'une boîte à bourdons sur l'exemplaire de Sèvres (voir sa
description) et donc très probablement ici également,
tuyau mélodique assez court, porte-vent tenu en bouche
Autre exemplaire à Sèvres
Fiche sur la base POP du Ministère de la Culture . https://pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM60000243?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D
(photo)
 ,
Menu général, Sommaire alphabétique, Départements, Personnages, Thèmes, lettre M, lettre O
,
Menu général, Sommaire alphabétique, Départements, Personnages, Thèmes, lettre M, lettre O

